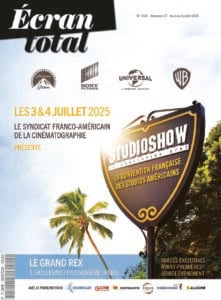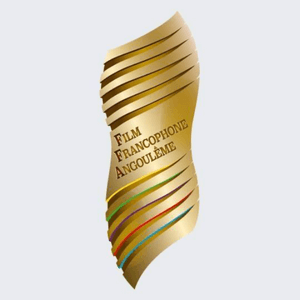Cinéma et Intelligence Artificielle : amis ou ennemis ?
C’est peu de dire que le nouvel essor de l’intelligence artificielle suscite bien des angoisses au sein de l’industrie cinématographique française et internationale, comme en atteste la grève qui paralyse actuellement Hollywood. Et pourtant, sur un plan purement historique, cette dernière n’est pas née de la dernière pluie puisqu’elle a fait son apparition dès 1956 comme l’a rappelé le modérateur des débats Michel Abouchahla, président d'Écran total, conscient des interrogations que soulève cette mutation, et des nouvelles opportunités qu’elle offre. « De nombreuses équipes de production ont intégré cette technologie dans le processus de création depuis longtemps. Si des inquiétudes légitimes se posent sur la question du volet social, il est aussi évident que de nouveaux emplois apparaîtront bientôt. Et ces derniers pourront multiplier à l’infini les capacités de la création artistique ».
La directrice générale de l’Ecole Polytechnique, Laura Chaubard, a d’abord rappelé la définition de l’intelligence artificielle. En l’occurrence, bien que cette dernière ait été conçue pour reproduire, et dépasser la performance humaine, elle demeure programmée pour reproduire ce qui a été précédemment conçu à partir d’exemples concrets préexistants qu’elle a pu intégrer. « Un outil comme ChatGPT ne connaît ni la conjugaison, ni la sémantique française, mais se nourrit de nombreux textes originaux qu’il a intégré. Donc la qualité de la création artistique générée par cet outil ne peut que dépendre des œuvres dont il s’est nourri préalablement. Je reste sceptique sur sa capacité à faire preuve d’une intention, voire d’une pensée ». Ainsi, cette technologie ne semble pas (encore) en capacité d’inventer les grands récits inédits et renouvelés de demain. « Le souci, c’est que l’IA impacte en premier lieu des paramètres que nous pensions exclusivement réservées à l’humanité, telle que la pensée et la créativité ».
Un outil amplificateur
Après avoir fait ses preuves en réalisant plusieurs fictions interactives (Wei or Die) ou télévisuelle (3615 Monique) ainsi qu’un premier long métrage (Drone, en cours de production par Haut et Court), Simon Bouisson a eu l’occasion de se familiariser avec l’intelligence artificielle aux Etats-Unis où il a séjourné, qu’il considère davantage comme un outil permettant d’optimiser ses récits et de gagner du temps dans l’écriture de ses scripts plutôt que comme un créateur à part entière. « Je n’ai nullement l’intention de me séparer ou de remplacer mes coscénaristes, témoigne le réalisateur. L’idée est de se servir de la machine pour multiplier nos idées et nos possibilités. J’ai une vision vertueuse de l’IA. Elle nous défie fortement mais soulève aussi des problématiques juridiques. J’ai intégré dans la machine 77 scénarios de films dont je souhaitais m’inspirer afin de créer de nouvelles images à partir de ces fragments. Mais le pôle juridique de ChatGPT m’a aussitôt averti qu’il y avait un risque de violation de propriété intellectuelle ».
De son côté, la réalisatrice Anna Apter a conçu son court métrage, Imagine, uniquement sur la base de l’intelligence artificielle. « Je désirais parler de la solitude que suscite notre ère numérique. Cette technologie a repoussé mes limites et débridé ma créativité. Elle m’a aussi permis de réaliser des économies de production car je n’avais pas les moyens financiers pour rassembler une équipe technique ».
Olivier Gorce, l’auteur qui a récemment co-scénarisé L’Abbé Pierre : une vie de combats avec Frédéric Tellier, se montre plus craintif. « La question prioritaire est de savoir quelles histoires nous souhaitons raconter. Je souhaite bien du courage à l’IA pour remplacer une autrice comme Sophie Fillières (récemment disparue, NDLR), avec son art du loufoque, de la surprise et de la rupture. L’écriture reste un processus artisanal, humain, intime. Cette fragilité ne risque-t-elle pas d’être perdue par ces outils mal utilisés dans le but d’aller toujours plus vite. Toutefois, dans le cadre du film d’Anna Apter, je reconnais que l’IA peut avoir un effet vertueux et cohérent par rapport à son propos. Le danger serait de demander à l’intelligence artificielle de créer un film capable d’exploser le box-office. C’est une responsabilité politique que de s’emparer d’un tel sujet et de l’encadrer au mieux afin d’éviter toutes dérives ».
Une capacité d’adaptation bienvenue
Après avoir traversé tant de révolutions culturelles, l’ancien ministre de la Culture (père de la loi de 1985) et actuel président de l’Institut du Monde Arabe, Jack Lang, s’est montré rassurant et confiant dans la capacité de l’État à accompagner cette technologie et dans celle de l’industrie à s’adapter face à ce nouveau bouleversement. « Je ne suis pas technophile mais pas technophobe non plus. D’autant plus que les phobies ont souvent été désavouées. Quand la photographie est apparue, on craignait un désintérêt pour la peinture. Quand le cinéma a été inventé, on prédisait la mort du théâtre. Et quand Canal+ est arrivé, les jours du cinéma étaient soi-disant comptés. D’ailleurs, aujourd’hui, une ville comme Angoulême est une des capitales de notre cinéma d’animation. Or, après son heure de gloire avant la guerre, avec des écoles mondialement réputées, l’animation française avait disparue. Puis nous avons initié le Plan Image en 1985 afin de faire renaître le cinéma d’animation. Cette initiative a coïncidé avec l’apparition des premiers outils numérique d’animation. Nous pensions que cela allait réduire à néant notre tentative de sauvetage. Cela a été tout l’inverse. Ces nouvelles technologies ont permis la renaissance de l’animation française. Il nous faut donc désormais songer à mettre en place une série de répliques juridiques afin de préserver et protéger nos auteurs. Cela afin d’éviter le pire et tirer le meilleur d’un outil qui, par bien des aspects, peut aussi faire rêver. L’éducation doit aussi demeurer notre priorité. La jeunesse doit être sensibilisée à ces questions. Dans notre système d’éducation, l’épanouissement des émotions, des sens et des imaginaires doivent être aussi reconnus que les apprentissages scientifiques ».
En somme, l’ensemble de ses échanges laisse à penser que l’intelligence artificielle peut être davantage considéré comme un ami qu’un ennemi, à condition qu’elle soit utilisée à bon escient et encadrée juridiquement. « L’optimiste invente l’avion, le pessimiste invente le parachute », a conclu Michel Abouchahla, citant George Bernard Shaw.